
Qu’est-ce que l’antispécisme ? En quoi est-il un transhumanisme ? Quel lien avec l’Esprit de Défense ?
SUGY (Paul), "Étienne BIMBENET : « L’homme est infiniment plus qu’un animal », in Le Figaro, 6 avril 2018.
par Nghia NGUYEN
Alors que la « cause animale » semble être devenue le dernier combat progressiste à la mode, Étienne Bimbenet met en garde contre un zoocentrisme trompeur, qui tendrait à ne plus regarder l’humain qu’au prisme des sciences naturelles. Au risque de ne plus voir en l’homme qu’un animal comme les autres... Étienne Bimbenet est professeur de philosophie contemporaine à l’université Bordeaux Montaigne. Il vient de publier Le Complexe des trois singes. Essai sur l’animalité humaine (éd. du Seuil, 2017).
__________
Figarovox - Vous affirmez dans votre livre que notre rapport à l’animal est en train de changer, sous l’effet d’un « zoocentrisme » que vous dénoncez. En fait, vous vous en prenez aux « antispécistes » ?
Étienne BIMBENET - L’antispécisme n’est pas qu’une idéologie : c’est d’abord un combat qui, malgré sa radicalité et ses outrances, va dans le bon sens, celui d’une prise de conscience salutaire concernant l’indignité de certaines méthodes industrielles d’élevage. C’est un militantisme qui consiste à prendre en considération les souffrances animales pour les atténuer. Mais sous-jacent à ce combat, en revanche, on trouve souvent une thèse beaucoup plus contestable : nous serions, humains, des animaux comme les autres.
Bien sûr, la plupart des animaux sont doués comme nous d’une sensibilité (d’une « sentience », comme disent les éthiques animales), qui exige que nous prenions en considération leurs souffrances, comme nous le faisons entre humains. Sauf qu’on glisse souvent, implicitement, de cette égalité morale à une égalité réelle, ou d’une égalité de considération à une égalité de condition. Nous serions plus fondamentalement animaux qu’humains, ou plus fondamentalement vivants que parlants ou rationnels. D’eux à nous, la différence serait moins importante que les points communs. Or ce « zoocentrisme » est discutable. Je le discute dans mon livre, en considérant qu’il en dit long sur notre époque, et sur l’état de notre sensibilité aujourd’hui.
- Selon vous, le zoocentrisme repose premièrement sur un « pari naturaliste »…
Oui, on peut apercevoir plusieurs types de distorsions ou d’aveuglements qui motivent cette nouvelle proximité avec les animaux, et qui font qu’elle est la plupart du temps très sincère. Une première distorsion regarde notre rapport à la science. Nous vivons un moment fortement « naturaliste » de notre savoir, dans lequel la priorité est donnée aux sciences de la vie et de la nature pour expliquer la réalité, au détriment de tout ce que nous apportent les sciences humaines. La théorie synthétique de l’évolution, l’éthologie, la primatologie, les neurosciences, exercent un monopole sur les discours qui s’intéressent à l’homme et à l’animal.
Il ne s’agit pas, bien entendu, de contester chacune de ces sciences. Mais je crois que les sciences sociales, la psychologie de l’enfant et de l’apprentissage verbal, les sciences politiques, pour ne citer qu’elles, ont aussi des choses essentielles à nous apprendre sur notre humanité, que la biologie ne peut pas nous dire. Lorsque vous considérez l’être humain en biologiste, vous ne le regardez qu’en tant qu’animal : il est donc normal, comme le dit le philosophe Francis Wolff, de conclure que l’homme est un animal. Il est vrai par exemple que l’homme partage 98,6% de ses gènes avec le chimpanzé ; mais conclure à partir de là que l’homme est un « troisième chimpanzé », c’est juste oublier que la génétique n’est pas tout. C’est le problème que pose à mon sens la pensée de Frans de Waal, le fameux primatologue néerlandais. S’il y a bien du « singe en nous », comme il ne cesse de nous le rappeler, si les grandes caractéristiques humaines ont des « précurseurs » dans les comportements des chimpanzés, cela ne signifie pas que la morale ou la politique, par exemple, ont le même sens chez eux et chez nous.
Une morale humaine ne se réduit pas à une simple capacité d’empathie. C’est une institution, une éducation longue, un corps de règles qui cultivent et systématisent l’empathie, et lui donnent un sens inédit dans l’ordre des comportements animaux. Une fois encore, rien de ce qu’affirment ces sciences n’est faux en soi ; mais, entendu de façon unilatérale comme l’unique discours possible sur l’homme, cela pose problème.
- Mais alors, les sciences naturelles sont coupables de cet aveuglement ?
Le propre des sciences de la nature est d’avoir un pouvoir de conviction très fort : elles nous obligent à remettre en cause des évidences que nous pensions indéracinables. Nous vivons sur une Terre plate, c’est ce que nous pensons spontanément, et pourtant la science moderne nous a appris un jour qu’en réalité la Terre était ronde ! C’est ce qu’on appelle en philosophie la « suspension de l’incrédulité » : tout ce que nous tenions jusqu’ici pour vrai, nos convictions les plus élémentaires, est susceptible d’être un jour démenti par la connaissance scientifique. Or je pense que ce crédit donné aux sciences de la nature est l’un des moteurs fondamentaux du zoocentrisme. C’est là que nous avons besoin des sciences humaines pour retrouver une forme d’équilibre, plus proche de ce que nous vivons et faisons tous les jours, comme êtres humains. On ne sait pas grand-chose d’un billet de banque si on se contente de connaître sa composition matérielle. Au-delà du savoir strictement physique, il y a tout ce que les économistes, les historiens ou les sociologues peuvent nous dire sur lui, comme convention ou comme institution. De même la génétique ou le fonctionnement cérébral ne représentent qu’un point de vue très restreint sur ce que je fais chaque jour comme être humain : les rites de politesse, les paroles échangées, les convictions morales ou politiques, les curiosités scientifiques ou artistiques…
- Et par-dessus cette vision tronquée de la réalité, se greffe une nouvelle morale ?
Oui, c’est une autre distorsion : une forme de moralisme. Le raisonnement est simple, même s’il est là encore contestable : ce qui pendant des siècles a autorisé la maltraitance des animaux, c’est de les avoir considérés comme différents de nous. C’est donc, pensons-nous, cette distinction entre l’homme et l’animal qui est coupable. Comme bien d’autres différences fortes, celle-ci nous gêne, elle nous paraît discriminante, nous ne l’assumons plus. Or il y a deux façons d’affronter ce type de différences. Soit, comme c’est souvent le cas aujourd’hui, nous nous en débarrassons, nous les dénions, comme nulles et non avenues. C’est une étrange stratégie, à laquelle je ne pense pas que nous ayons beaucoup à gagner dans nos relations avec les animaux. Soit au contraire nous regardons en face cette différence entre eux et nous, nous l’assumons ; et nous décidons alors de respecter les animaux, au-delà de tout ce qui nous sépare d’eux. C’est ce que j’appellerai, par opposition au déni, un « respect de vérité ». Autrement dit respecter leur mystère, leur exotisme, les aimer à distance, sans projeter en eux des sentiments humains, trop humains…
- Le zoocentrisme vous a donc inspiré cette comparaison avec les trois singes de la sagesse, qui refusent de voir, d’entendre et de parler…
Oui, je reprends cette fameuse figure héritée de Confucius puis du bouddhisme : trois singes dont la sagesse est de refuser de voir le mal en face, de l’entendre, et de le répéter. Le zoocentrisme, en criminalisant la différence entre l’homme et l’animal, refuse de voir qu’elle existe, et par conséquent ne veut plus l’entendre et encore moins la dire. Comme si c’était offenser les animaux que de les penser différents de nous ! Cet aveuglement est d’autant plus pernicieux qu’il se présente sous les traits d’un progressisme. Écouter ce que disent les scientifiques naturalistes, c’est faire preuve d’ouverture d’esprit ; écouter les souffrances des animaux, c’est faire preuve de générosité ; refuser toute définition métaphysique de l’humain, c’est jouer les esprits forts. Qui oserait lutter contre cela ? Sauf qu’à mon avis on peut mieux faire, être plus précis, plus fidèles à ce que vivent concrètement les hommes et les animaux.
En fait, je crois que notre époque a un problème avec la différence, ou plus largement avec le donné. Parce que nous y voyons une source possible de discriminations, nous préférons réfuter l’idée même de différence, comme le fait par exemple le féminisme queer à l’égard de la distinction biologique entre les sexes. Pourtant cette attitude n’est pas satisfaisante : autant on peut mettre en évidence la construction sociale des comportements sexués (ce qu’on appelle la construction des « genres »), autant je ne crois pas que nous puissions douter un seul instant de la différence des « sexes » chez les mammifères que nous sommes. Rien n’interdit d’imaginer une reconnaissance de cette différence sexuelle, au plan biologique, couplée avec un profond respect pour les tenants de l’un et l’autre sexe, au plan social, et un refus absolu de toute forme d’inégalité.
- N’y a-t-il pas cependant un paradoxe entre le zoocentrisme et la théorie queer : l’un réduit la réalité au naturalisme, tandis que la seconde prive les sciences naturelles de tout discours sur l’humain pour ne s’intéresser qu’aux sciences sociales ?
C’est vrai : d’un côté les théories queer s’appuient sur un constructivisme fort, de l’autre le zoocentrisme s’en remet à un naturalisme exacerbé. Mais les deux se rejoignent pourtant dans un commun refus des différences (biologiques pour les uns, sociales et culturelles pour les autres), dès lors que celles-ci sont vécues comme imposées. Comme si, pour être libre, il fallait oublier ces différences, refuser de prendre en compte ce qui nous est donné. Or je pense que la meilleure manière d’être libre n’est pas de dénier ou de refuser de voir ce qui est, mais au contraire de l’affronter, et de construire sa liberté en connaissance de cause.
- D’accord, mais comment ?
En considérant par exemple, si l’on revient aux animaux, à quel point prendre conscience de nos différences nous rend responsables. C’est à nous, en particulier, qu’il appartient de construire une philosophie des droits qui soit plus inclusive et englobante. Car seul l’homme est capable d’inventer le droit, de changer radicalement ses mœurs pour mieux prendre en compte la considération que nous devons avoir pour l’ensemble du vivant. L’animal, lui, n’est qu’un patient moral : il est incapable d’une telle construction. Je propose ainsi un « anthropocentrisme élargi », qui part de la différence homme-animal pour justifier un plus grand respect de l’animal. Ce qu’on aperçoit chez le vivant humain, c’est une formidable capacité de décentrement à l’égard de soi, une étonnante capacité à prendre en compte d’autres intérêts, parfois très lointains, comme la souffrance des animaux, comme le sort des générations futures, comme la préservation d’un écosystème menacé, ou d’un vallon, ou d’une forêt… Ces décentrements, ces lignes de fuite, partent de nous, et peuvent aller très loin. Si donc nous voulons une amélioration du sort des animaux, cela ne peut venir que de l’humain : la responsabilité nous en incombe.
- Ainsi, vous partagez avec les zoocentristes le combat pour une meilleure considération de l’animal, en luttant par exemple contre les élevages en batterie…
Absolument ! L’association L214 a par exemple le mérite, comme lanceur d’alerte, de faire évoluer les sensibilités, et de nous mettre en face de nos responsabilités. On peut ne pas partager leur radicalité et ne pas être, comme eux, « abolitionnistes » ; il n’empêche qu’ils sont efficaces et que leurs images, parce qu’elles ont été massivement relayées, ont largement contribué à informer l’opinion.
- Pensez-vous que les animaux ont des droits ?
On pose souvent cette question en ce moment, mais je pense qu’il faut la formuler autrement. Les animaux n’ont aucun droit. Pas plus du reste que les humains. Ce qu’il faut dire en revanche, c’est que les hommes ont été capables de se donner à eux-mêmes des droits, c’est-à-dire un statut qu’ils n’avaient pas naturellement, et qu’ils ont inventé. De la même façon, il est parfaitement envisageable de construire des droits pour les animaux : droit de sécurité, de survie, de bien-être, etc. La bonne question serait donc plutôt : « Voulons-nous inventer des droits pour les animaux ? ».
Or cette question regarde d’abord nos sensibilités, et la manière dont nous nous voyons les uns les autres. Il se trouve que nous nous voyons, entre humains, comme sacrés les uns pour les autres, car nous avons appris à le faire. Une longue éducation nous a appris à considérer le meurtre de l’autre homme comme un acte criminel, ou en tout cas exceptionnel. Il est tout à fait opportun de réaliser un travail semblable avec les animaux. Vivre avec eux, les voir en face, mais aussi imaginer leurs conditions d’élevage, le plus concrètement possible, toutes ces pratiques peuvent faire évoluer notre relation avec eux. De plus en plus, nous les verrons non plus comme une simple matière à notre disposition, mais au contraire comme des vivants ou des sujets, appelant de notre part une certaine considération. Un enfant ne mangerait pas son hamster. Car il le voit comme un compagnon, et non comme un morceau de viande ou un objet à sa merci.
- L’animal peut-il être en quelque sorte le « miroir de l’homme », au sens où voir l’animal dans l’homme nous dit quelque chose de nous-même ?
Oui, je crois que cette animalisation de l’homme nous dit quelque chose d’essentiel sur nous-mêmes, aujourd’hui. C’est au fond une affaire politique. Elle regarde une forme d’illusion qui guette de plus en plus nos démocraties. On peut considérer que vivre ensemble c’est délibérer, construire en commun, projeter ensemble l’avenir de notre communauté. Mais on peut croire inversement que l’important, c’est plutôt de se préserver de toute atteinte, ou de tout jugement, de la part d’autrui. Dans une telle conception appauvrie du vivre ensemble, nous serions d’abord et avant tout des individus vivants et seulement vivants, cherchant chacun à s’assurer de ses droits, et à préserver son autarcie. À ce stade où chacun vit sa vie comme il l’entend, toutes les vies se valent et il n’y a aucune raison de faire la différence entre un homme et un animal. Or cette politique « immunitaire », cette politique de la « vie nue », c’est bien sûr une illusion, et nous le savons bien : il n’y a pas de « liberté naturelle », la liberté de vivre sa vie est le fruit d’une longue conquête historique et politique, cela suppose des institutions précises, une éducation, parfois du courage... Nous vivons ensemble parce que nous l’avons décidé et construit, et non par le seul fait de vivre. Nous sommes des vivants parlants et politiques, et non de « simples » vivants.
Paul Sugy
__________
- BIMBENET (Étienne), Le complexe des trois singes. Essai sur l’animalité humaine, Seuil, 2017, 352 p.
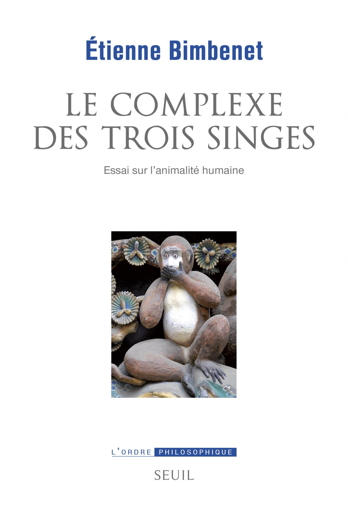
En passant par l’Histoire
Calendrier
 Plan du site
Plan du site
 Contact
Contact


2016-2024 © Éducation à la Défense et à la Sécurité nationale - Tous droits réservés



 Accueil
Accueil








